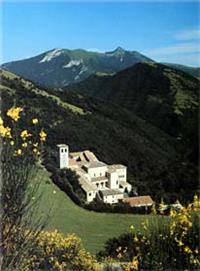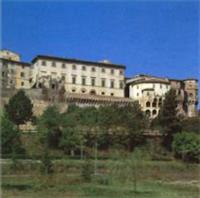SAN VITTORE DELLE CHIUSE
Definita
“gioiello” del romanico marchigiano, l’abbazia di San Vittore delle Chiuse
sorge all’imboccatura della gola di Frasassi, in una stretta valle scavata dal
fiume Sentino tra le pareti calcaree del Monte di Frasassi e del Monte
Vallemontagnana.
L’appellativo
de clusa o de clusis infatti, sembra indicare la posizione geografica della
chiesa, all’entrata orientale della Gola, oltre alla quale non si poteva
andare. La principale via di accesso era costituita da un ponte sul fiume
Sentino, tuttora esistente, costruito su un arco a sesto acuto, sul quale venne
edificata una torre/porta.
La
struttura attuale si data intorno agli anni 1070-1080 anche se del complesso
monastico abbiamo notizia già dal 1007. In una pergamena conservata alla
Princeton University Library, sappiamo che la fondazione del monastero risale a
questo periodo e che viene edificato in un fondo detto Victorianum. Sopravvivono la chiesa e i resti dell’antico
cenobio, oggi sede del Museo Speleopaleontologico e Archeologico.



Costruita
in calcare locale con inserti in travertino e in laterizio, esternamente è
decorata da lesene e archetti pensili. Sporgono in altezza il tiburio
ottagonale, una torre scalare cilindrica e una quadrangolare che entrambe
fiancheggiano l’ingresso. L’interno si regge su quattro pilastri che la
dividono in nove campate coperte a crociera, tranne la cupola centrale che è
impostata su una base quadrata e un tamburo ottagonale.
Ha tre
navate absidate, più una nave trasversale anch’essa absidata, alle due
estremità, ai lati nord e sud, si trovano anche due portali che rappresentano
il collegamento rispettivamente con il cimitero (portale nord) e il chiostro
(portale sud).
Nel
muro adiacente alla porta che conduceva al cimitero è possibile vedere il
simbolo dell’infinito, un variante dell’Uroboro, il serpente che si morde la
coda, riconducibile al concetto della ciclicità di tutte le cose e
dell’eternità.